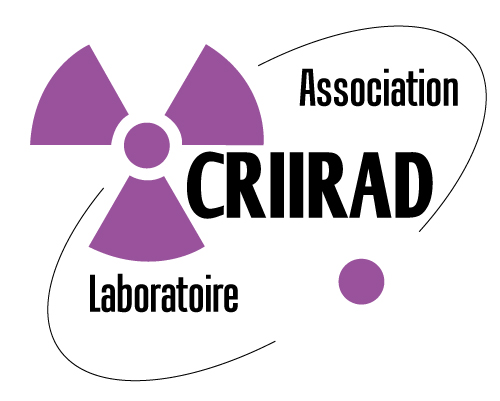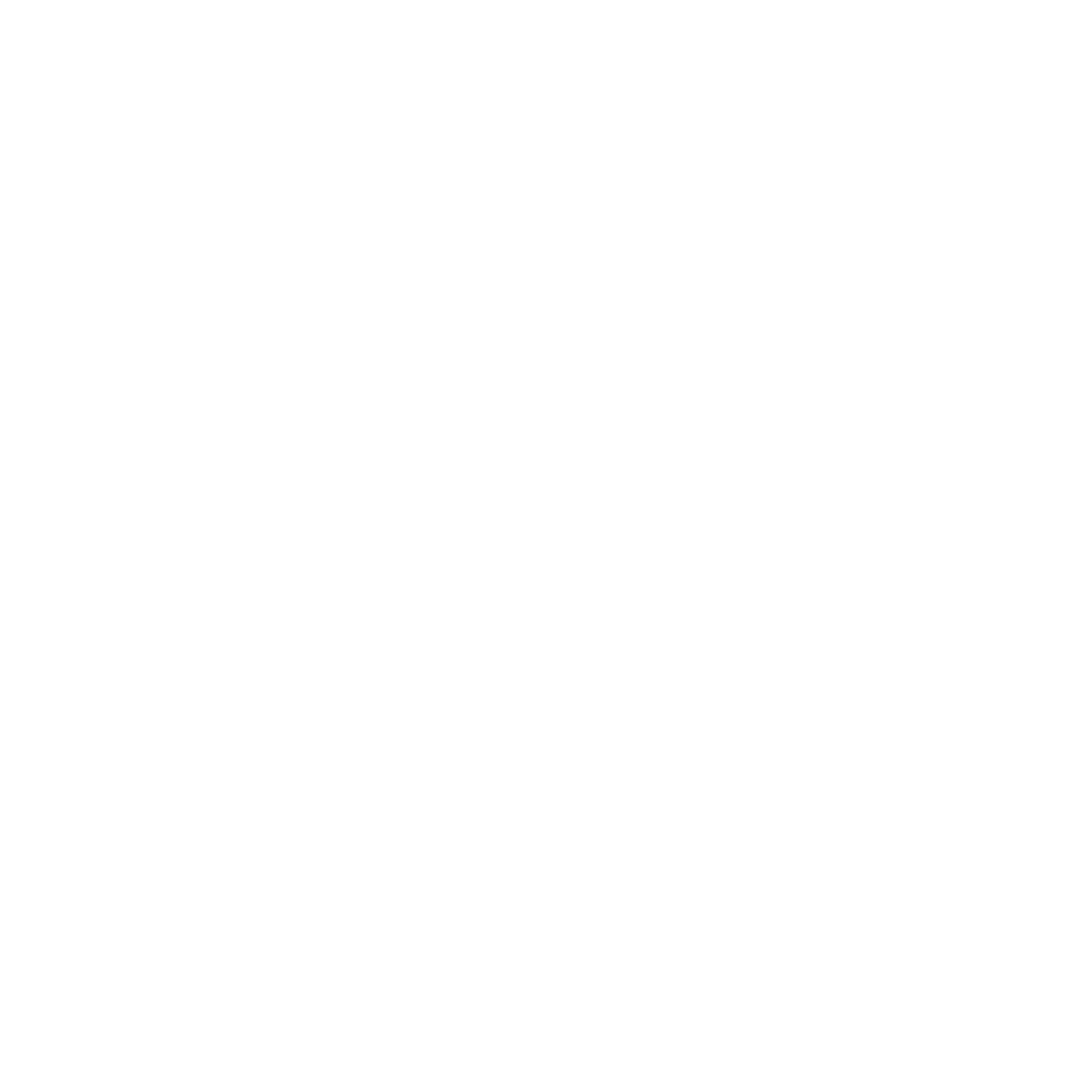Établissements recevant du public (ERP)
Les principes du dispositif réglementaire sont les suivants :
- les mesurages de radon sont obligatoires pour certaines catégories d’ERP situés dans certaines zones géographiques.
-
- les catégories d’ERP concernées par ces obligations sont :
- les établissements d’enseignement,
- les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans,
- les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement (hôpitaux, accueil des personnes âgées, accueil des personnes handicapées, …),
- les établissements thermaux,
- les établissements pénitentiaires.
- les catégories d’ERP concernées par ces obligations sont :
- les zones géographiques concernées sont :
- les communes situées en zone 3 (potentiel radon significatif), pour tous les établissements appartenant aux catégories précitées,
- les communes situées en zone 1 (potentiel radon faible) ou en zone 2 (potentiel radon faible mais présence de facteurs géologiques particuliers pouvant faciliter le transfert du radon vers les bâtiments), uniquement pour les établissements où les résultats de mesurages existants dépassent 300 Bq/m³.
En savoir plus sur le zonage géographique
- ces mesurages doivent être réalisés par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par des organismes agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire ;
- les résultats sont comparés à 300 Bq/m³ (il s’agit du niveau de référence de l’activité volumique moyenne annuelle en radon dans les immeubles bâtis) ;
- lorsque les résultats dépassent ce niveau, des actions de réduction de l’exposition au radon doivent être mises en œuvre. L’efficacité de ces actions doit être vérifiée par un nouveau mesurage ;
- lorsque les résultats sont inférieurs à ce niveau, aucune action corrective n’est imposée. Le mesurage doit être renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment. Lorsque les résultats de deux campagnes successives sont tous inférieurs à 100 Bq/m³, le mesurage décennal n’est plus obligatoire ;
- les résultats doivent être tenus à la disposition de plusieurs agents et organismes (inspecteurs de la radioprotection, inspecteurs d’hygiène et de sécurité, commissions de sécurité, comités sociaux et économiques, …). Le propriétaire doit, par ailleurs, informer des résultats les personnes fréquentant l’établissement.
LIEUX DE TRAVAIL
Avant le 1er juillet 2018, les obligations de contrôle concernaient très peu d’établissements, car elles portaient uniquement sur certaines activités professionnelles effectuées dans des lieux souterrains (entretien de voies de circulation, manutention de marchandises, maintenance d’ouvrage de bâtiment et de génie civil, …) ainsi que dans les établissements thermaux.
Entre la mise en place de cette réglementation (en 2010) et 2017, ce sont seulement 127 rapports pour toute la France qui ont été reçus par l’IRSN, à qui doivent être transmis les résultats. Et certains dossiers concernent le même établissement.
Désormais, le risque lié au radon doit être évalué pour toutes les « activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs en application de l’article L.1333-22 du Code de la santé publique ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ».
Les principes du dispositif réglementaire sont les suivants :
- dans un premier temps, l’employeur doit faire une évaluation documentaire du risque, en se basant notamment sur le potentiel radon du secteur où se trouve l’établissement, ainsi que le résultat d’éventuelles mesures de la concentration d’activité de radon dans l’air déjà réalisées ;
- lorsque les résultats de l’évaluation documentaire du risque montrent que l’exposition des travailleurs de l’établissement est susceptible d’atteindre ou de dépasser 300 Bq/m³ en moyenne annuelle, l’employeur procède à des mesurages de la concentration d’activité du radon dans l’air sur le lieu de travail. Ces mesurages peuvent être réalisés directement par l’employeur, ou confiés à une entreprise extérieure. Il n’est pas nécessaire de posséder un agrément pour les mettre en œuvre ;
- lorsque les résultats du mesurage montrent que l’exposition des travailleurs est susceptible d’atteindre ou de dépasser 300 Bq/m³ en moyenne annuelle, l’employeur met en œuvre des mesures de réduction des risques ;
- si, malgré ces mesures, les niveaux dépassent toujours 300 Bq/m³, les résultats doivent être transmis à l’IRSN (article R.4451-17 du Code du travail), et des actions spécifiques de gestion du risque lié au radon doivent être mises en œuvre (délimitation et signalisation de zones radon ; vérification périodique des niveaux de radon de ces zones ; évaluation de l’exposition individuelle ; si la dose efficace est susceptible de dépasser 6 mSv par an, surveillance dosimétrique individuelle et suivi individuel renforcé de l’état de santé).
HABITAT
Malgré quelques maigres avancées, l’habitat reste le parent pauvre de la réglementation française en matière de radon. C’est pourtant dans le logement que nous sommes le plus exposés au radon, compte tenu de la durée d’exposition. En effet, la population française passe en moyenne 67% de son temps dans son logement. Cette durée est plus élevée pour les enfants de 5 ans et moins (73%) et les personnes de 60 ans et plus (76%). Elle reste majoritaire pour les personnes exerçant une profession (63%).
En 1990, la Commission Européenne publiait la recommandation 90/143 relative à la protection de la population contre les dangers résultant de l’exposition au radon dans les bâtiments. La notion large de « radon dans les bâtiments » (indoor radon) s’appliquait à l’ensemble des bâtiments, y compris l’habitat. Ce texte n’avait pas de valeur obligatoire, mais il recommandait néanmoins :
- de définir un niveau de référence dans les bâtiments existants à 400 Bq/m³ ;
- de définir un seuil plus exigeant pour les bâtiments neufs (200 Bq/m³) ;
- d’établir des critères « permettant l’identification des régions, des sites et des procédés de construction susceptibles d’aller de pair avec des niveaux élevés de radon à l’intérieur des bâtiments ».
Malgré ce texte, avant le 1er juillet 2018, il n’existait en France aucune obligation en matière de gestion du risque radon dans l’habitat. Le dispositif réglementaire découlait de la directive Euratom 96/29. Ce texte réglementait l’exposition au radon dans les établissements recevant du public et les lieux de travail, mais excluait spécifiquement « l’exposition au radon dans les habitations » de son champ d’application. Celle-ci était cependant prise en compte dans une recommandation de la Commission européenne de 1990, un texte non prescriptif que les autorités françaises ont préféré ignorer.
Début 2009, l’Assemblée Nationale a bien étendu l’obligation de contrôle de radon aux propriétaires de certaines catégories d’immeubles bâtis, par la modification de l’article L1333-10 du Code de la santé publique. Selon l’ASN, ceci devait « permettre une extension du dispositif réglementaire notamment aux bâtiments d’habitation ». Mais les décrets d’application n’étant jamais parus, cette obligation est restée inopérante.
Avec la parution de la directive Euratom 2013/59, on aurait pu espérer de réelles avancées, puisque contrairement au précédent, ce texte n’exclut plus l’habitat de son champ d’application. Dans la pratique, l’évolution reste très limitée : il s’agit uniquement d’une obligation d’information a minima lors de la signature d’un contrat de vente ou de location d’un immeuble. L’« État des risques et pollutions » , qui doit être annexé au contrat comporte désormais une rubrique « radon », dans laquelle il doit être indiqué si « l’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 ».
La nouvelle réglementation n’impose aucune mesure de radon, aucune mise en œuvre d’actions correctives, que l’immeuble soit occupé par son propriétaire ou par des locataires. Ainsi, dans une même commune, la mairie est tenue de mettre en œuvre des actions correctives dans l’école publique si une concentration en radon de 300 Bq/m³ est détectée, alors que dans un logement où le locataire mesure 2 000 Bq/m³ de radon, le propriétaire n’a pas obligation d’agir.
Le caractère cancérigène du radon est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1987 et la recommandation européenne date de 1991. Au cours des trois dernières décennies, il était donc possible de mettre progressivement en place un accompagnement pour l’assainissement des logements existants et surtout pour instaurer des règles de construction permettant de limiter l’entrée et l’accumulation de radon (comme plusieurs pays l’ont fait).
Cela aurait permis d’éviter qu’un passif ne se constitue sur le parc de logements construits pendant cette période.
Pour prolonger
La CRIIRAD a réalisé un examen critique du dispositif français de gestion du risque « radon » en vigueur avant le 1er juillet 2018.
Le rapport est consultable ici.
Auteur : Julien SYREN – Dernière mise à jour : 14/12/21